
« La durée d’un film ne devrait pas dépasser la capacité de la vessie humaine » disait Alfred Hitchcock. Avec Killers of the Flower Moon, le grand Martin Scorsese n’a pas écouté ce conseil, étalant son retour historique sur le massacre des amérindiens de la tribu Osage sur près de 3h30.

Le film est l’adaptation de l’ouvrage d’enquête éponyme de David Grann. Ce livre retrace une partie de l’histoire de de la tribu native américaine Osage, qui est devenue extrêmement riche après la découverte de pétrole sur leur terre. Chose qui a bien sûr attiré la convoitise d’hommes blancs fortunés, et amené aux meurtres de plus de 60 membres de la tribu. Interpellé par les victimes, le tout récent Bureau of Investigation, ancêtre du FBI, vient mener l’enquête dans la ville de Fairfax Oklahoma et s’intéresse de près à William Hale, éleveur très puissant qui semble tirer les ficelles de cette extermination lente.
En préambule à cet article, il faut aborder la démarche de Martin Scorsese qui, à l’instar de David Grann, propose un retour qui se veut le plus fidèle possible à la réalité historique. Pour cela, un large travail de recherches a été mis en oeuvre, il s’est entouré de consultants Osage, de conseillers culturels et est allé jusqu’à tourner son (très) long-métrage sur les terres où les événements se sont produits, à savoir l’Oklahoma.
Mais en parallèle de ce travail visant à reconstituer une page sombre de l’histoire états-unienne, le génial cinéaste en profite pour contredire tout un pan de la mythologie américaine entretenue par le genre fondateur d’Hollywood : le western.

En parlant de l’histoire du western, on peut presque parler en parallèle de l’histoire du cinéma, les débuts du genre se confondant avec les débuts du septième art.
Beaucoup de ses représentants ont délivré au cours des décennies une représentation de plus en plus humanisante et factuelle des différentes communautés natives et de leur rôle dans la construction des États-Unis. En traversant ainsi les époques, le genre s’est adapté à la doxa évolutive de celles-ci. Pour avoir un exemple assez parlant, il suffit de confronter La Chevauchée Fantastique (1939) de John Ford, oeuvre fondatrice de la forme classique du genre, aux Cheyennes (1964), dernier western tourné par ce même John Ford.
Le premier présente la tribu Apache comme une masse sombre et inquiétante de sauvages sanguinaires, alors que le second aborde l’épisode historique de la longue marche des indiens Cheyennes du point de vue de ces derniers, en admettant assez directement le génocide à l’oeuvre durant cette période.
Cependant, les indiens que l’on peut découvrir dans ce film ne sont, pour la plupart, pas interprétés par de véritables natifs mais par des comédiens hispaniques. Personne n’est parfait.

C’est peut-être ici que l’on peut expliquer l’ambition de Martin Scorsese à montrer à l’écran une représentation au plus proche du réel. Le cinéma américain n’a que trop rarement mis tous ses moyens à contribution pour offrir aux spectateurs une image correcte des différentes tribus natives.
Il a pourtant été reproché à Scorsese d’adopter le point de vue des blancs dans Killers of the Flower Moon. Sauf que premièrement, c’est oublier le rôle important de Lily Gladstone, qui porte en elle toutes les souffrances de son peuple, et qui voit l’intégralité de sa famille se faire assassiner. Deuxièmement, le sujet du long-métrage est bien d’exposer, selon moi, le rapport des américains blancs à leur propre histoire.
En rendant ses protagonistes, à savoir Ernest Burkhart (Leonardo DiCaprio) et son oncle William Hale (Robert De Niro) totalement détestables au point qu’ils montrent une facette peu reluisante sur l’origine des États-Unis et du capitalisme, le cinéaste italo-américain démontre que le western a dans son ADN de mettre en scène la légende au détriment de la vérité. Il perpétue alors cette tendance du western crépusculaire qui dénonçait les artifices du genre, où la légendaire conquête de l’Ouest voyait ses héros se transformer en hommes vieillissants, colonisateurs et cupides, et où les indiens passaient du statut de pur antagoniste à celui de victime se battant pour sa liberté.
Et la démarche cinématographique du réalisateur octogénaire emprunte ce chemin, puisqu’il réalise une sorte d’anti-western, ou de western que l’on pourrait qualifier non sans humour de nocturne. Déjà parce qu’il reprend beaucoup de codes du genre (les colons, les indiens, les hommes de main, les bagarres et les décors), mais surtout parce qu’il déplace ceux-ci pour raconter une histoire désormais éloignée en terme de temporalité de la conquête de l’Ouest, puisqu’on se situe au sortir de la Grande Guerre. Et pourtant, on peut observer un processus de colonisation génocidaire toujours à l’oeuvre alors que l’apaisement entre colons et natifs semblaient acquis.

L’arrivée d’Ernest à Fairfax peut ainsi s’analyser comme un début assez classique de western, celui du héros arrivant par le train dans une contrée qui lui permettra de changer de vie et de faire fortune.
Or les décors ne sont que peu mis en valeur, aucune scène d’action ne vient faire souffler le récit. Le héros est un idiot fainéant, corruptible et vénal. En bref, beaucoup d’ingrédients sont présents pour réaliser un western, mais Scorsese en crée quelque chose de dissonant.
Les grandes fresques fondatrices de l’histoire des États-Unis sont loins, rien de bien chevaleresque, pas de guerre ou d’affrontements, pas de personnages perdus dans l’immensité des plaines américaines. Non l’Histoire, la vraie, est aussi une affaire de machination discrète, intime et pernicieuse.
Cela fait déjà de Killers of the Flower Moon un film très stimulant en tant qu’œuvre proprement cinématographique, mais aussi un film extrêmement politique, puisqu’il contredit tout un pan de l’imaginaire créé en partie par le cinéma hollywoodien des années 1940 et 1950. Il s’agit là d’un geste courageux et rédempteur, une grande thématique scorsesienne, mais qu’il semble autant appliquer à ses personnages qu’à l’ensemble des américains, dont il fait partie.

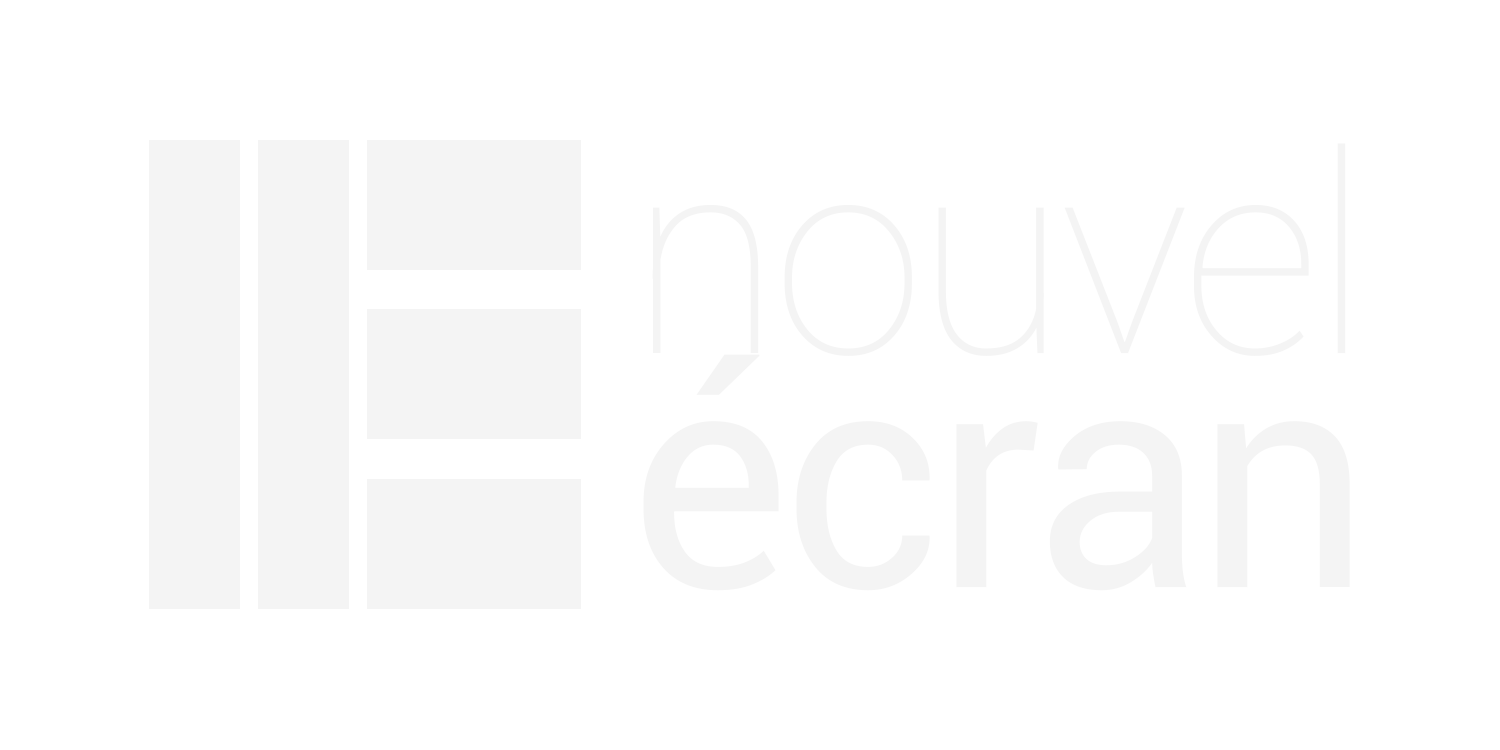
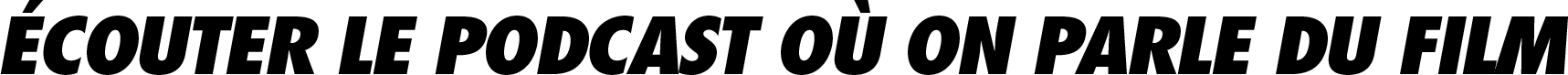
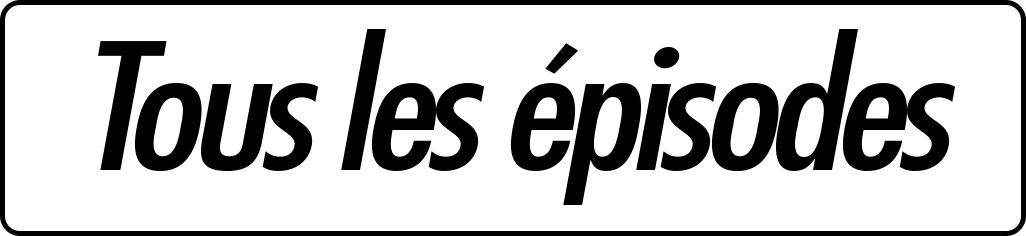



Pingback:TOP 2023 - nouvel écran