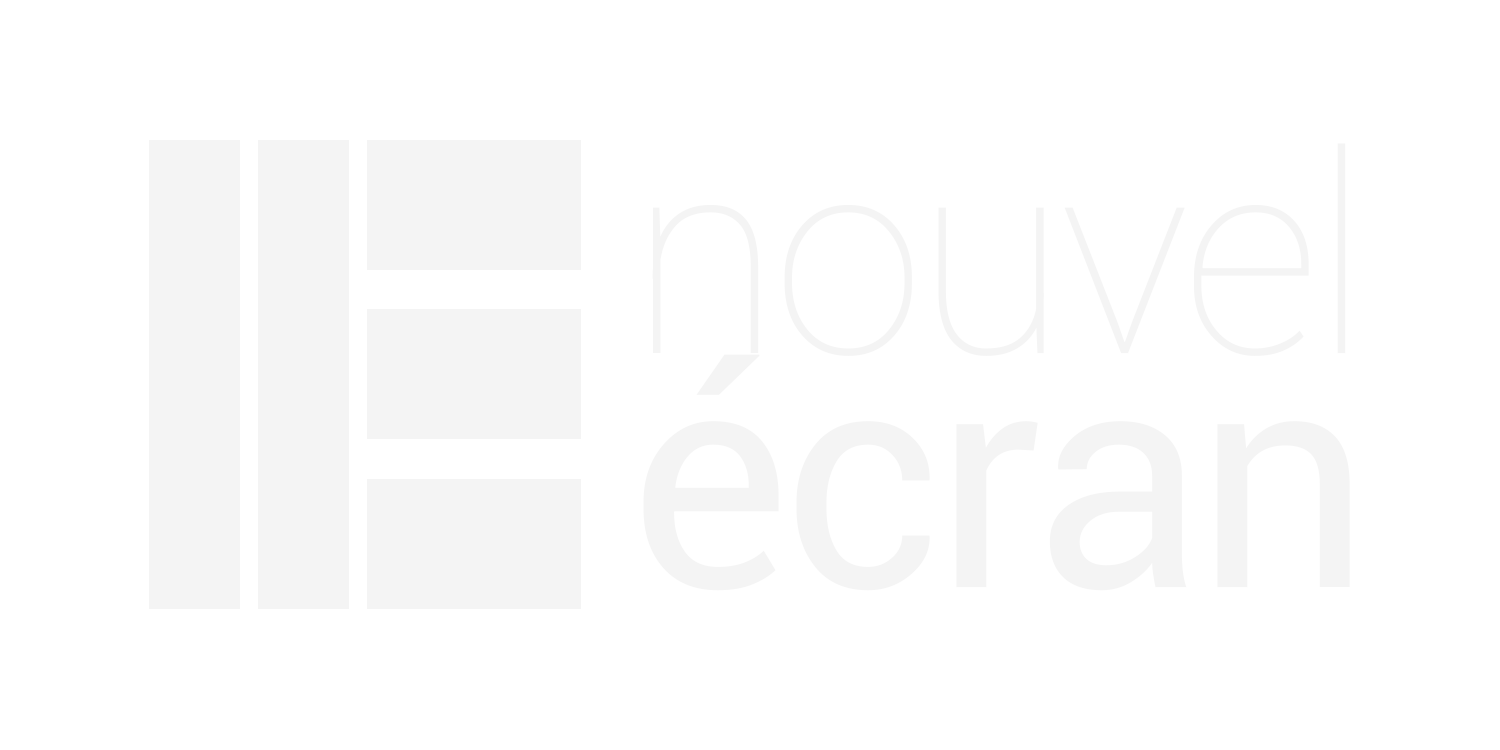Comment ont-ils pu ? Une question qui revient sans cesse lorsque l’on se penche sur les actes abominables commis par le régime nazi. De là, on s’imagine les sous-fifres de cet état totalitaire comme des robots sans âme, obéissant sans le moindre recul aux ordres. On les imagine tantôt dénués de toute pensée critique, tels des idiots dociles, tantôt comme des monstres assouvissant leurs pulsions les plus malsaines.
En montrant le quotidien d’une famille dont le père n’est autre que le gardien du camp d’Auschwitz-Birkenau, Jonathan Glazer, avec La Zone d’intérêt, établit une vérité plus floue, qui ne réduit jamais les SS à de simples bureaucrates qui font bien leur travail, sans pour autant en faire des figures absolues du mal.

Reparti avec le grand prix du Festival de Cannes 2023 et énormément commenté depuis, The Zone of Interest était extrêmement attendu en ce début d’année. Et pour cause, l’adoption d’un point de vue montrant les petits tracas de cette famille nazi a de quoi faire parler par sa radicalité inédite.
De plus, aborder ce sujet ô combien traumatique est un pari risqué pour un cinéaste qui n’en est qu’à son quatrième long-métrage.
Au-delà du sujet passionnant que Glazer aborde ici, c’est bien par la forme de son film qu’il démontre sa maîtrise de cinéaste.
Dès son ouverture, La Zone d’intérêt ne nous montre rien. Un écran noir accompagné de la musique dissonante de la compositrice Mica Levi s’impose à nous pendant environ deux minutes, créant un temps d’adaptation avant d’entrer dans cette observation froide des mécanismes de l’horreur. Mais cet écran noir nous incite également à prendre de la distance quant à ce qui demeure une fiction sur l’une des plus grandes exactions de l’espèce humaine. Et pour finir, il fait office de note d’intention du metteur en scène sur son dispositif qui tend à nous faire entendre ce que l’on ne peut voir, et voir ce que l’on ne peut entendre.

Car ce qui suit est une sidérante plongée dans le quotidien affreusement banal de la famille Höss. Tour du propriétaire, fête d’anniversaire, départ et retour du travail, baignade dans une rivière, dîners. Tout est mis en œuvre pour faire de cette famille une famille moyenne, dans laquelle chacun peut se reconnaître. Mais notre attention demeure toujours ailleurs, le film s’efforce de nous montrer ces parents et leurs enfants, mais l’arrière-plan et le hors-champ s’imposent à nous comme une funeste évidence.
De la fumée des fours crématoires aux cris lointains des prisonniers, le contexte dans lequel se déroule cette histoire familiale convenue nous est toujours rappelé.
Lors d’une avant-première au cinéma L’Arlequin de Paris, Christian Friedel, l’acteur principal, nous expliquait que Jonathan Glazer avait imaginé deux films, l’un visuel et l’autre sonore. Et c’est bien l’imbrication des deux qui nous met dans un profond état de malaise.
Car si l’on prend l’histoire visuelle, il ne s’agit que d’un récit mettant en scène une famille dans son quotidien un peu morne mais heureux, jusqu’à ce que l’homme soit muté temporairement loin du domicile et que la femme se sente de plus en plus seule en son absence, quitte à s’imaginer le tromper.
Seulement, on découvre les aléas de cette famille en ayant toujours une partie de l’arrière-plan nous montrant les structures du camp d’Auschwitz, les aboiements de chiens ou les coups de fusils en fond sonore.

Les individus ayant œuvré pour la solution finale ne se sont pas mis soudainement à danser dans les flammes en poussant des rires machiavéliques, ils ont simplement continué leur vie. Ils ont continué d’effectuer leur travail, de se marier, de faire des enfants, de fêter des anniversaires. Et c’est bien cela qui glace le sang et que théorisait Hannah Arendt avec son concept de « banalité du mal ».
Mais comme tout grand film, La Zone d’intérêt brille moins pour ce qu’il illustre de cette période sombre que sur ce qu’il dit de nous.
Le dispositif mis en œuvre par Jonathan Glazer lors du tournage en dit d’ailleurs beaucoup sur ses intentions. Avec cinq caméras placées dans la maison et l’équipe à l’extérieur de celle-ci, les comédiens pouvaient circuler relativement librement dans l’espace et tourner ainsi plusieurs scènes simultanément. Les plans fixes à distance des personnages rappellent les mécanismes d’une télé-réalité, Glazer a d’ailleurs résumé son concept à Christian Friedel comme étant « Big Brother chez les nazis ».
Cela augmente notre intérêt pour cette famille tout en nous empêchant d’avoir de l’empathie pour eux, notamment via l’absence totale de gros plans, ce qui crée de nouveau une forte dissonance, entre fascination et répulsion.
En se plaçant et en nous plaçant comme simples observateurs et en utilisant des codes visuels que les spectateurs de 2024 connaissent bien, Jonathan Glazer nous montre la facilité avec laquelle des personnes, dans un contexte donné, par conviction ou par volonté de survie, embrassent une nouvelle réalité, participent à la façonner, pour qu’elle finisse par devenir une norme dans laquelle les habitudes simples reprennent leur place.
Toute l’ambiance sonore du camp a été ajoutée en post-production, ce qui explique, en plus des prestations remarquables de Christian Friedel et Sandra Hüller, l’absence de réactions des personnages face à l’horreur que l’on entend. L’industrialisation de la mort, son organisation, sa rationalisation font perdre tout état d’âme aux protagonistes, comme s’ils vivaient à côté d’une simple usine.

Le film est une expérience dérangeante, qui agit comme un poison lent, marquant durablement nos rétines et nos tympans par son épouvantable simplicité. En redonnant leur humanité à ces êtres qui ont participé au génocide de plusieurs millions de personnes, l’œuvre glisse de l’étude mécanique vers l’avertissement. Les intentions de ces personnes n’intéressent que peu Glazer, ce qui explique une fois encore l’absence de plans sur les visages des comédiens. Qu’ils agissent par patriotisme, peur ou réelle adhésion à l’idéologie nationale-socialiste, leurs préoccupations rejoignent celles de tout un chacun, ils recherchent une forme de bonheur et d’accomplissement personnel.
La médiocrité se retrouve même au cœur d’un des événements les plus sombres de l’Histoire humaine, le mal ne survient pas, il se propage de manière presque invisible et indolore tel un poison lent. Et c’est bien ce qu’est La Zone d’intérêt, un poison lent qui hante votre mémoire au nom de la Mémoire.