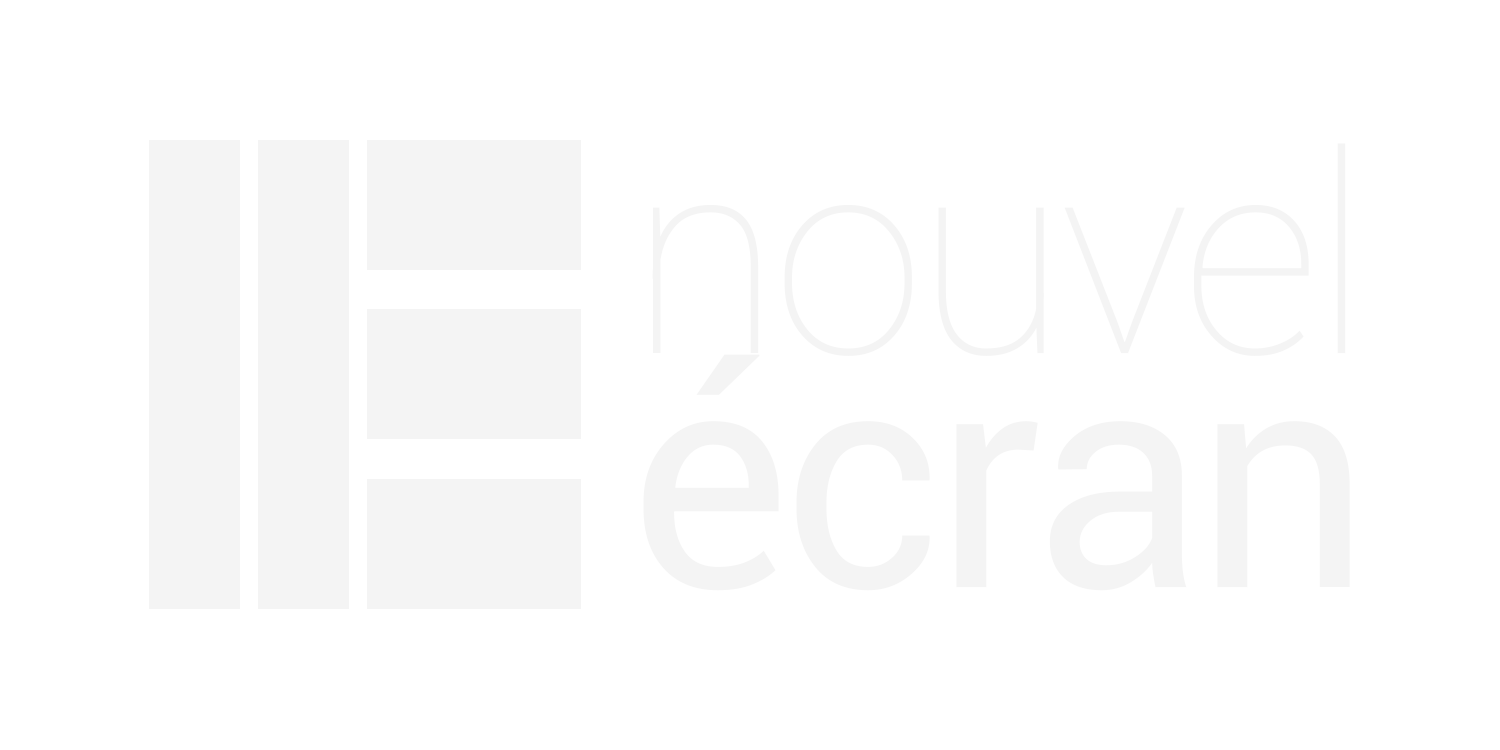À force de voir de nombreux films, de les commenter, de les analyser, de les classer, si ce n’est de les caser dans une mouvance artistique et/ou esthétique, on en oublie parfois l’une des forces vertueuses du septième art : celle de véhiculer des idées.
Pier Paolo Pasolini, dans sa réponse au courrier d’un lecteur de Vie Nuove qui le questionnait sur la censure, rappelait que le cinéma « est un formidable instrument de diffusion idéologique » (texte à retrouver dans l’essentiel Dialogues en public, publié aux éditions Corti). On y devine alors que cet art peut faire office de contre-pouvoir remarquable face à un État bien aidé par des médias à sa botte.
On me voit peut-être venir. Je vais parler ici d’un contexte sociopolitique très dense et de deux films que j’ai eu le plaisir de découvrir récemment. Ils forment à mes yeux un parallèle passionnant à la période trouble que la France vit autour du gouvernement d’Emmanuel Macron et de sa réforme des retraites
« impopulaire ».
Du quotidien des oubliés d’Atlantic Bar à la lutte ouvrière de L’Établi, on va voir comment, par un probable hasard de calendrier, le cinéma peut se faire l’écho de la réalité et donner des exemples et des visages aux débats qui animent notre tant citée démocratie.


Ce qui rend cette double analyse d’autant plus intéressante à mon sens, ce sont les formes choisies par les deux cinéastes que sont Fanny Molins (Atlantic Bar) et Mathias Gokalp (L’Établi).
La première nous livre un documentaire à la fois dur et tendre sur la vie des tenanciers d’un bar d’Arles et de leurs amis, habitués des lieux.
Le second met quant à lui en scène une fiction sur un « établi », un intellectuel communiste infiltré en tant qu’ouvrier au sein d’une usine pour y organiser la lutte contre un patronat répressif. Une fiction qui n’en demeure pas moins proche du réel puisqu’elle est l’adaptation de l’ouvrage autobiographique éponyme de Robert Linhart.
Deux approches relativement différentes qui tissent des liens forts et sans doutes fortuits avec la période de crise sociale que nous connaissons. Fanny Molins nous donne à voir les raisons pouvant amener à une telle colère populaire, et le caractère injuste d’une politique menée contre une partie de la population. De son côté, Mathias Gokalp met en images les méthodes des uns pour défendre cette même population, et celles des autres pour endiguer son éventuelle révolte.
Un film sur le fond, un autre sur la forme. Une oeuvre sur les causes, une autre sur les conséquences. Un présent éloquent, un passé éclairant.


Il a été maintes fois argumenté que la réforme des retraites, tout juste promulguée, s’apprête à frapper de toute son injustice les plus défavorisés, les fameux « gens qui ne sont rien » selon notre aimable président. Atlantic Bar prend le pari risqué de poser sa caméra à la hauteur de cette France oubliée, peuplée d’individus abandonnés devant les crocs acérés de la gentrification, de la loi du marché, des inégalités de richesse.
La démarche est risquée par la difficulté de donner à voir des personnes qui ont pour certaines vécu la misère (l’un des clients du troquet a été abandonné à l’âge de deux ans par son père et a survécu à la précarité en faisant des braquages, un autre a été à la rue pendant trois années). Pourtant le documentaire évite tous les écueils en ne tombant pas dans un voyeurisme misérabiliste mais, au contraire, dans un portrait poignant et humanisant de ces quidams qui se réfugient dans leur amitié, leur entraide et dans ce lieu qui les rassemble.
Tous les débats qui animent la place publique ces temps-ci trouvent ici une illustration crue, cruelle de l’état de notre pays. Évidement, le film ne parle pas de la fameuse réforme, ayant été tourné bien avant son « cheminement démocratique ». Celle-ci n’est pas le fond du problème, elle n’est qu’un symptôme d’une politique menée envers et contre tous (enfin presque). Lorsque l’on met de côté les anecdotes amusantes, les moments de danses poétiques et les bons mots de la tenancière charismatique qu’est Nathalie, c’est bien une forme de résignation que l’on voit se dessiner sur les visages captés par Fanny Molins.
De la même manière que dans En Plein Feu (Quentin Reynaud – 2023) vis-à-vis de la catastrophe écologique, on nous montre ici des gens contraints de « vivre avec ». Ils mènent leur vie en dépit des difficultés, essayent de se battre pour conserver le peu qu’ils ont, ce pour quoi ils ont travaillé, sué et investi. Sans succès.
Le seul espace dans lequel ils peuvent se retrouver et s’échapper le temps d’un verre, c’est ce bar, menacé d’une fermeture qui finira malheureusement par advenir, enterrant avec elle une conception du commerce comme lieu rassembleur, ouvert à tous grâce à des tarifs accessibles, loin d’une logique de profit à tout prix.
À une période où la contestation se construit autour de la défense des français les plus durement touchés par la politique menée depuis (au moins) six ans, voir une oeuvre donnant la parole à ces derniers, dépeignant avec tendresse ces corps accoudés est capital. « Comprendre, c’est déjà aimer » disait Bernanos.


De son côté, L’Établi trouble par l’histoire vraie qu’il raconte. D’une certaine manière, il rejoint la démarche d’Atlantic Bar en mettant en scène des intellectuels maoïstes qui tentent justement de sentir la réalité des ouvriers du pays à la fin des années 1960. Ils essayent de cerner ce qui anime ces corps abimés par les gestes répétitifs, dictés par un patronat qui ne porte pas vraiment d’attention sur les conditions de travail au sein de l’usine.
Et le constat le plus touchant et vrai que fait Robert Linhart (Swann Arlaud), c’est bien que la répétition et la fatigue générée par celle-ci enlève aux travailleurs l’opportunité de penser. Que ce soit dans l’action à l’usine ou au retour chez soi au sortir d’une journée éreintante, l’idée même de réflexion devient trop ambitieuse au regard de l’épuisement accumulé. Ce que nous dit cet état de faits, c’est que l’organisation même du travail porte déjà une volonté de répression, celle des idées.
Or c’est bien l’objectif visé par Robert Linhart. Enrichi par cette découverte, il va impulser un mouvement contestataire, bien aidé par un ultime affront du patron Junot (Denis Podalydès), demandant à ses employés de travailler 45 minutes supplémentaires par jour, gratuitement, afin de rattraper le manque à gagner provoqué par les grèves de mai 1968.
Je passerai ici sur les détails entourant l’élaboration de la grève et les méthodes employées par Linhart et ses camarades pour la mener, car ce sont les procédés utilisés par Junot pour endiguer la révolte qui m’intéressent, tellement la parabole avec l’actualité est saisissante.
Dans le recours à la violence, physique comme verbale, au chantage, au renseignement et à des techniques visant à décrédibiliser les grévistes (notamment en provoquant des actions violentes), le film met en scène, dans un contexte différent, ce que vivent aujourd’hui les très nombreux opposants à la réforme macroniste. Les supporters nantais et toulousains qui se sont rendus au Stade de France le 29 avril dernier s’amuseront peut-être des séquences où la milice patronale réprime les distributions de tracts syndicalistes à l’entrée de l’usine.
La parabole avec le mouvement de 2023 s’étend même jusqu’au déclencheur de cette contestation, une augmentation du temps de travail sans contrepartie, et des justifications aussi lunaires qu’injustes.


Que dire maintenant ? Déjà, une œuvre, qu’elle soit cinématographique ou non, semble échapper, à un moment donné, à ses créateurs. Dans le cas présent, c’est moi, et peut-être vous, qui analysons ces gestes artistiques à l’aune du temps présent.
Or il ne faut pas se méprendre. Même si les deux cinéastes n’ont pas réalisés leur film dans une volonté de commentaire aux tensions actuelles, ils ont toutefois tourné leur métrage durant le premier quinquennat de la macronie, souhaitant probablement en montrer les effets néfastes sur la population. Les gilets jaunes et la gestion discutable de la période Covid étaient déjà passés par là et formaient un terreau propice à l’élaboration du portait d’une France qui n’a pas beaucoup changé depuis.
De plus, face à une presse écrite, radiophonique ou télévisuelle détenue en majeure partie par quelques milliardaires, qui ne manque pas une occasion de se taire face aux nombreuses violences policières et aux mensonges à répétition des membres de la majorité présidentielle, que nous reste-t-il pour nous informer, pour débattre, réfléchir à la situation ?
Eh bien je pense qu’il faut revenir à Pasolini (il faut toujours revenir à Pasolini). Même si le cinéma n’a plus une place aussi dominante dans le quotidien de la population que dans les années 1960, il peut tout de même être un vecteur important d’idées et de discussions.
Lorsque notre bon roi nous affirme qu’il ne faut pas politiser le sport, ce n’est pas parce qu’il le pense, c’est parce qu’il craint le potentiel de tels événements pour véhiculer des idées et réveiller les consciences. Il en est de même, à mon humble avis, pour l’art.
Mais je ne serais pas complètement honnête si je n’évoquais pas le peu de succès rencontré par les deux longs-métrages, qui ont été relativement peu distribués (133 copies pour L’Établi, 25 pour Atlantic Bar). L’objet de ce texte est bien de militer pour une plus grande visibilité à ce type de propositions. Pour y parvenir, il faudra les efforts conjoints de spectateurs plus demandeurs, de cinéastes plus libres, de producteurs et de distributeurs plus aventureux.
Le jour où le ministre de l’intérieur menacera de fermer les cinémas, nous aurons peut-être atteint cet objectif.
En conclusion, je ne trouverai pas mieux que ces quelques mots du mythique artiste italien qui rappellent que la censure est, plutôt qu’une interdiction, un détournement de l’attention.
En résumé, lorsqu’on parle de censure, on commet souvent une très
grave erreur : on accepte de discuter sur le terrain choisi par les censeurs, […] alors qu’il faudrait tout au contraire ignorer complètement le prétexte qu’ils invoquent hypocritement : même un enfant comprend bien que la censure est d’abord une affaire politique.
Pier Paolo Pasolini, “À propos de la censure”, in Dialogues en public, éditions Corti, 2023, p.39